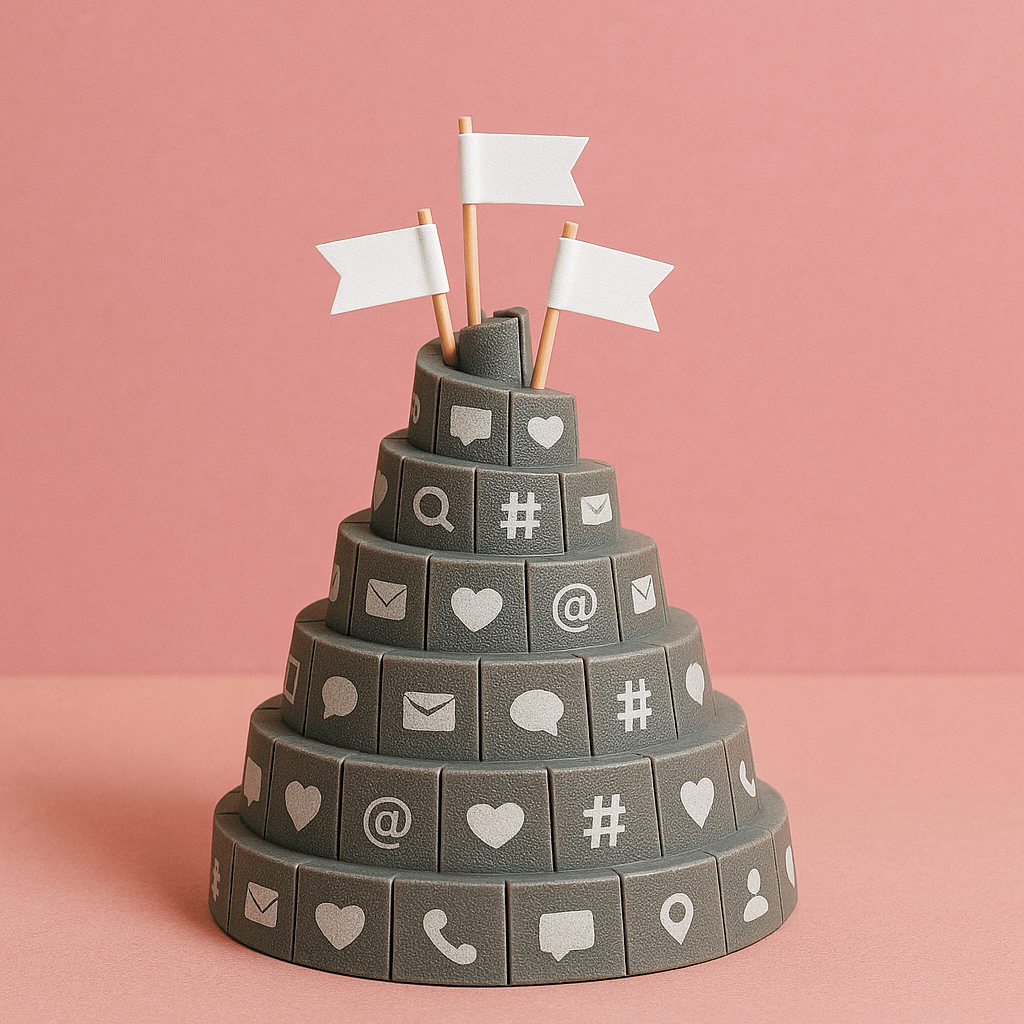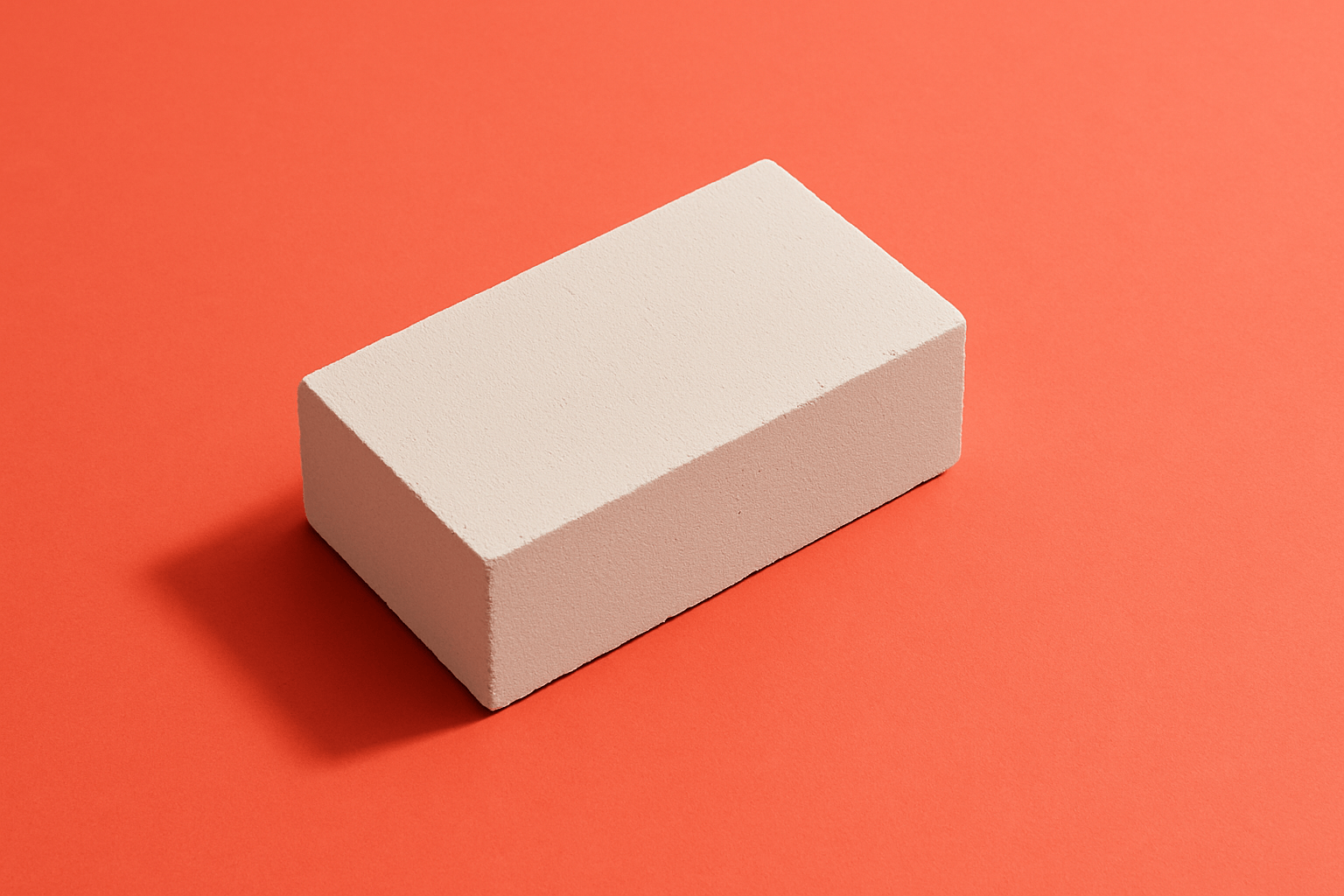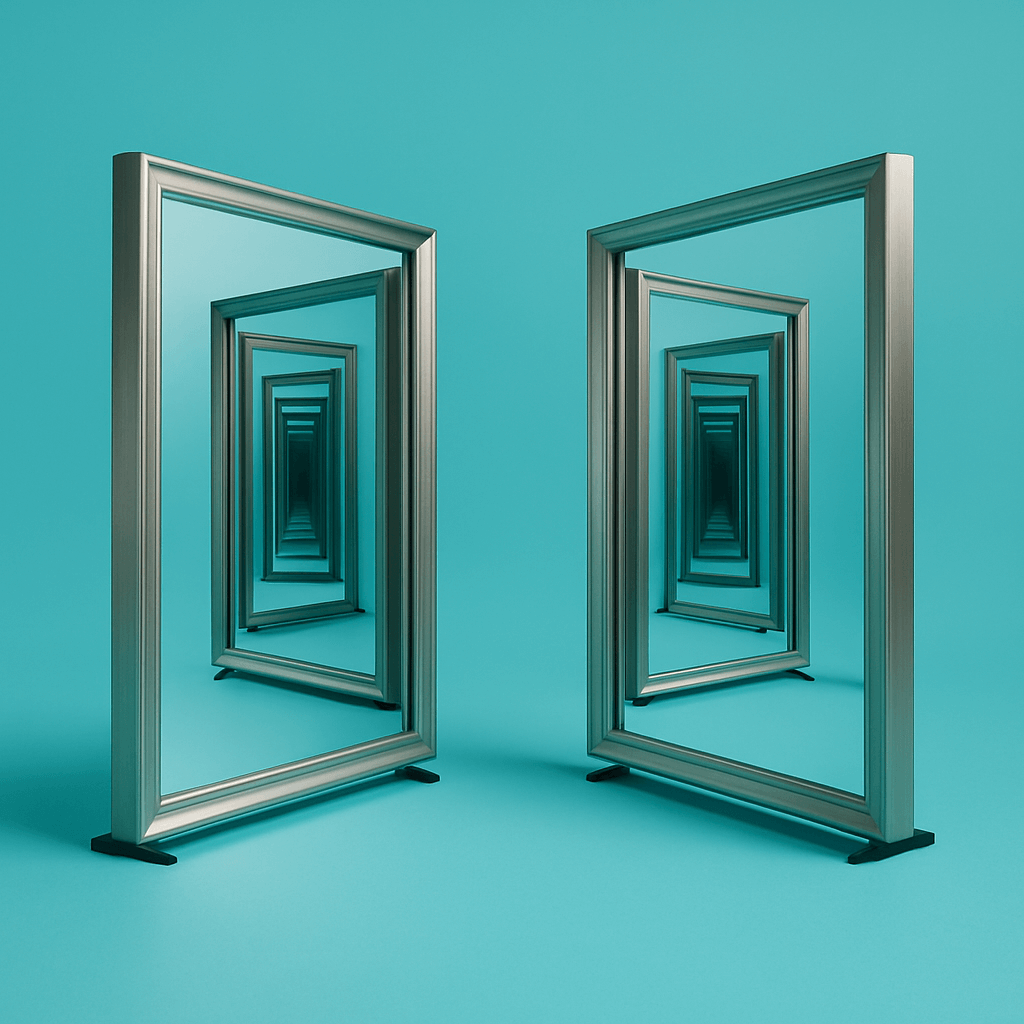Ce que l’intervention présidentielle révèle d’un pouvoir devenu bavard et impuissant
La communication a longtemps été un privilège, une ressource rare. Elle était l’instrument d’un pouvoir centralisé, souverain, qui s’adressait à ses sujets depuis un piédestal : rois, églises, gouvernements. Celui qui parlait dominait. Celui qui écoutait obéissait. Le message descendait, sans appel, sans réplique.
Puis le monde s’est ouvert. La mondialisation a bousculé les frontières, pas seulement économiques ou culturelles, mais symboliques. Les États ont perdu peu à peu le monopole du discours. D’autres puissances ont pris le relais — les marques. Plus agiles, plus sensibles aux mouvements d’opinion, elles ont appris à parler le langage des émotions, de l’appartenance, du “purpose”. Coca-Cola n’a jamais vendu que du sucre. Apple, des machines. Nike, des baskets. Mais elles ont toutes prétendu dire quelque chose de la vie, de l’humain, du sens.
Face à cette montée en puissance narrative, les institutions ont tenté de s’adapter. Branding, storytelling, éléments de langage : le vocabulaire du marché a infiltré le politique, le public, l’universel. Mais ce mimétisme n’a pas suffi. Car pendant ce temps, une autre rupture s’est produite — plus radicale encore.
Ce ne sont plus seulement les entreprises qui parlent. Ce sont les individus. Chaque citoyen est devenu un média potentiel. Une caméra, une connexion, une idée : voilà de quoi toucher des milliers, voire des millions de personnes. Le pouvoir de communication ne se centralise plus. Il se diffuse, il s’éparpille, il s’incarne partout.
Et avec lui, les idées aussi circulent. Parfois brillantes, parfois délirantes. Mais toujours contagieuses. Les réseaux sociaux n’ont pas seulement donné la parole — ils ont amplifié la dimension idéologique de cette parole. Chacun peut devenir le porte-voix d’un courant, d’une croyance, d’une vérité personnelle. Et plus le message est chargé émotionnellement, plus il fonctionne. Ce n’est plus le fond qui compte, c’est la charge. L’intensité, pas la cohérence.
Alors on parle beaucoup, mais on s’écoute peu. On s’indigne vite, mais on argumente rarement. Les mots s’entrechoquent, mais ne se rencontrent pas. La vérité devient une expérience subjective, non un objet commun. L’échange n’est plus une quête de compréhension, mais une performance.
Ce chaos bavard n’est pas sans rappeler le mythe de la tour de Babel. Nous pensions créer un langage unique, un espace commun, une plateforme qui nous rapprocherait à l’unisson d’un idéal. Mais l’égalité est bien peu de chose face à l’individualisme, et à trop vouloir nous faire entendre, nous avons inventé un nouveau sens au mot confusion. La langue n’est plus une barrière, mais le Dieu algorithme que nous nous sommes inventé finit par nous diviser, en maximisant l’engagement au détriment du sens.
C’est dans ce contexte qu’est intervenue l’allocution du Président de la République, ce 13 mai. Un moment politique, sans doute. Mais aussi un révélateur symbolique. Le format choisi est celui d’une époque révolue : interview télévisée, confrontation encadrée, discours attendu. Un homme seul face à quelques figures médiatiques, exposé mais encore protégé. Il parle, il défend, il assume. Mais rien ne déborde. Le script est connu.
Ce que cela raconte, ce n’est pas une erreur de communication. C’est un modèle qui peine à survivre. Ce n’est pas qu’on ne puisse plus s’exprimer ainsi. C’est qu’on ne peut plus le faire sans que cela sonne creux. Sans qu’on sente la dissonance entre le fond — parfois sincère — et la forme — profondément verrouillée.
Il n’y a plus de tour d’ivoire d’où l’on puisse parler sans contradiction. Mais il existe encore mille façons de communiquer sans jamais se confronter au réel. Ce n’est plus le silence qui isole, c’est le déni de conversation.
Et c’est précisément ce qui nous intéresse, chez Blank Space Agency. On n’a la solution miracle, il n’y en a pas. Mais on refuse de continuer à faire de la communication comme on produit des discours : fermés, lisses, désincarnés. On croit à une parole qui s’expose, qui doute, qui accepte de se faire contredire. À une communication qui ne cherche pas à gagner, mais à comprendre. C’est moins spectaculaire. Mais c’est plus durable. Et surtout, plus nécessaire.